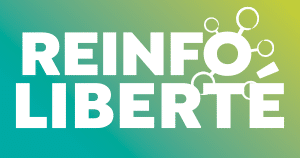Artistique
2 ANS : une nouvelle (hyper) réaliste
- le 27 avril 2022

Voici le témoignage, dans toutes les fonctions de ce dernier, de déboires d’étape liés aux effets que l'état d'urgence sanitaire produit dans ma simple existence, au fil de deux années écoulées dans le calendrier de la justice de proximité.
Je sais que beaucoup d'autres sont plus mal lotis. Car certain.e.s me l'ont exprimé sans savoir dans quel paysage mental je recueillais leurs confidences. J’ai écouté, je n’ai rien confié. C’étaient mon rôle, ma posture, ma fonction. Car mes canaux d’information me laissaient entrevoir la nature, l’ampleur, l'orgie et le lucre de la répression déployée partout dans les territoires.
À la dernière heure du 17 avril 2020, au temps de notre premier enfermement par l'État, j'avais rendu une visite à mes parents âgés, comme j'en avais pris l'habitude paisible depuis un mois jour pour jour. Elle s'est déroulée dans le respect des conditions d’alors, très restrictives des libertés fondamentales : 1 km maximum du domicile, d'une durée d'1 heure maximum, muni de l'auto-attestation d'auto-dénonciation et d’auto-contrôle. Je l’avais choisie comme unique sortie quotidienne autorisée, en dehors de celles, moins limitées, dévolues aux courses.
Nous n'avions pas encore subi de couvre-feu. Aux heures où je savais ne devoir croiser personne, je rendais cette visite en soutien du moral et dans la veille des effets de l’étrange quotidien sur mes ascendants, pour qu'ils continuent à bénéficier d'une présence physique aussi rapprochée que possible, pour contrecarrer la menace de la distanciation sociale, pour prendre soin d’eux. Je n'entrais pas dans les pièces de vie de la maison, je me tenais à l'extérieur ; dans la fraîcheur du soir printanier, ils ouvraient leurs volets à mon arrivée ; nous discutions de tout et de rien, du plus sérieux au plus trivial, au plus banal. Parfois, dans le garage en entresol, je soupais rapidement à une petite table de jardin couverte d'une nappe en plastique, mobilier qu'après avoir fait ma vaisselle, je nettoyais pareillement à l'éponge, à l'eau chaude et au savon de Marseille. Je ne m'essuyais pas les mains au torchon ni à la serviette, uniquement au feuillet de papier absorbant écologique que j’emportais pour le jeter aux toilettes chez moi. Je n’allais ni aux toilettes ni à la salle de bain. Je touchais les poignées de portes ganté, j'actionnais les interrupteurs au coude. Systématiquement, mon père me rejoignait au garage, nous discutions d’affaires sérieuses, de ce que l’avenir augurait et de la transformation abrupte du monde. Dans les nimbes du doute général, nous maintenions de commun accord une distance interpersonnelle de 2 mètres. Nous nous sommes soutenus par ces rituels pendant deux mois.
Cette dernière heure du 17 avril, j'avais également travaillé une vingtaine de minutes aux deux carrés de fraisiers du jardin, sarclé autour des plants afin qu'ils profitent au mieux, en ce printemps sec, des pluies nocturnes annoncées. Des plants alimentaires conduits d'ordinaire pour l'agrément, et dès lors devant l'incertitude de l'avenir. Bien soignés, généreux, ils ont depuis doublé naturellement de vigueur comme en nombre, et jaillissent d’une floraison pleine de promesses.
Vers minuit vingt, je rentrais tranquillement à pied à travers la petite ville parfaitement déserte, quand dans ma rue sur le côté de trottoir prescrit aux piétons par le Code de la route, à 30 mètres de l'entrée de mon domicile, j’ai été intercepté par une patrouille de gendarmerie en Renault 4 L bleue revampée ou quelque chose comme ça d’une allure un peu hi tech désuète, je suis nul en bagnoles...
J’ai entendu le véhicule débouler au carrefour derrière moi, puis s’engager dans ma rue, dans ma direction. Il m’a suivi au ralenti sur une quinzaine de mètres pendant une vingtaine de secondes puis s’est avancé à ma hauteur. Ils étaient deux à bord, lui au volant, elle à la place passager avant. Des mois plus tard, j’ai compris à travers une abréviation figurant dans les documents judiciaires qu'il s'agissait d’effectifs de la brigade de la ville. Entre habitants discutant devant les commerces lors de nos sorties d'approvisionnement, nous accusions, à tort comme à raison, les renforts de troupes venus de la préfecture.
Je leur ai indiqué le motif de ma sortie. Il s’y est repris à quatre fois pour parvenir à qualifier une infraction. Il a commencé par se gausser avec sa collègue du papier d’auto-dénonciation, dont la forme paraissait le chiffonner, puis a tenté sans succès de me faire admettre qu’une infraction au code de la route équivalait à une sortie à pied pour rendre une visite familiale, une absence de rapport dont je lui ai fait part. La passagère, d’abord partie à la gausserie, s’est rapidement effacée de la conversation sitôt que j’ai prononcé « nous verrons avec le procureur de la République », comprenant peut-être qu’elle avait la qualité de témoin. Lui a continué seul le contrôle, inquiet et sur la défensive. Il m’a reproché notamment d’« interpréter la loi », ignorant au passage cette qualité citoyenne. Pour se sortir d’affaire, il a coupé court à l’entretien et s’est précipité à conclure, en me proférant par la vitre entrouverte, cette assertion absurde ourlée de perversité...
"Vous n'avez pas le droit de rendre visite à vos parents."
…, qui n’avait d’autre but que de blesser, et qu’une rapide recherche a posteriori dans la Foire Aux Questions du site du Ministère de l’Intérieur a formellement contredite.
Je me suis accroupi, genou au sol, pour passer un regard très droit dans l'entrebâillure de la vitre et le braquer dans ses yeux, d’homme à homme. D’une voix posée et libre, j’ai asséné :
« J’ai parfaitement le droit de rendre visite à ma famille. Et je le ferai. Quoi qu’il advienne. »
Au moment où ils ont pris congé, à la fois satisfaits et marris d’avoir verbalisé à l’arraché, je leur ai dit que je ne les remerciais pas. Elle me regardait de ses yeux maquillés, grand ouverts d’une inquiétude qui cédait à l’angoisse. Lui passait à autre chose, au suivant. Il commençait à tomber de grosses gouttes, obliques et cinglantes dans le vent soudain glacial. C’était il y a deux ans.
Lointaine, aveugle, bouffie de numérique, la bureaucratie de la répression s’est mise en marche. J’ai contesté selon la procédure, d'un courrier en recommandé de 5 pages plus les pièces. Le procureur de la République engagea les poursuites, le juge du Tribunal de Police prononça une première condamnation par ordonnance pénale sans examiner les faits et les circonstances. J’ai formulé une première opposition. Je devais comparaître le 12 janvier 2022, pour qu’on examine et statue à nouveau. Mon avocate a botté en touche pour une raison confuse de circonstances sanitaires ne permettant pas les plaidoiries, et m’a transmis une lettre demandant le report d’audience, afin d’avoir le temps d’accéder au dossier et de préparer la défense. Je n’ai jamais su si cet accès s’était matérialisé. Au jour dit, le secrétariat de son cabinet m’a juste précisé que selon leurs informations, la demande avait été transmise.
Le 12 janvier 2022, les circonstances ont fait, crucialement sans doute, que je ne suis pas parvenu à me rendre physiquement au Tribunal distant de 40 km pour obtenir le report d’audience, lettre en main. Le Greffe est resté injoignable toute la journée par téléphone : aucune réponse, puis soudain une seule d'un homme qui ne s'est pas identifié, n'a pas décliné ses fonctions, s'est débarrassé de l’appel sans plus d’explication en le transférant dans le vide des tonalités perpétuelles. Par courriel, l’adresse destinataire du Tribunal s’est avérée non valide, pourtant fournie par le site de la Cour d'appel. Le cabinet d'avocats ne paraît pas avoir eu plus de certitude.
Mais les audiences se sont tenues. Le 10 mars 2022, cachet judiciaire faisant foi, le Greffe a établi le jugement et l’ordonnance de condamnation définitive en première instance ; je n’en ai eu connaissance qu’il y a tout juste une semaine en les récupérant chez l’huissier. Dans le jugement définitif, édifiante sinon attendue, est apparue la conclusion tautologique que j'ai bien commis les faits considérés. Il est aussi écrit que le contradictoire a eu lieu. Entre le juge et le procureur, sans la défense. Dans les 10 jours du délai imparti pour faire appel, avant de former une décision, je me suis fait préciser les possibilités d'intervention de mon assurance protection juridique : la protection ne peut être mobilisée dans un tel projet de procédure contre les dispositions et les effets de l'état d'urgence sanitaire. Je suis amené à renoncer à faire appel, au regard des 3000 euros qu'il me faudrait assumer en propre et de l'insuffisance prévisible de l'aide juridictionnelle à solliciter, sans garantie de relaxe. Ainsi vont la loterie et la roulette. Ainsi se verrouillent les serrures qui ferment la cage.
Il ne m'aura pas été possible de me défendre au-delà de ma première opposition à ma condamnation par ordonnance pénale. Dans une société démocratique saine d’esprit, en quoi une telle visite pourrait-elle raisonnablement relever d’une infraction ? Dans son arbitraire, mû par le zèle – j’ajoute, l’excitation - le gendarme en a juste fabriqué une, ou peut-être plusieurs, je n'en sais rien, car le contenu du procès-verbal n'a été communiqué ni à mon avocate ni à moi-même. Je me rappelle qu’au tout début du contrôle, tandis que j’observais le désir qui l’habitait, j’avais mis au jour son intention première :
Moi : "Quel est votre objectif, Monsieur ?"
Lui, par la vitre entrouverte : "Vous verbaliser."
Le libellé de l’article de l’état d’urgence sanitaire, tous trois calibrés à dessein pour que tout et tout le monde puisse être poursuivi, invisibilise le réel en dissimulant la vérité. Et je suis d'avis que si le juge et le ministère public avaient cherché stratégiquement par les procédures à m'intimider et à me bâillonner pour me dissuader d'attaquer l'État, ils ne s'y seraient pas pris autrement. Aujourd’hui, je ne vois pas bien comment je parviendrais à contrer cela, sachant qu’en cette matière pénale, l'action collective n'est pas admise en droit français. Il ne me reste que quelques jours, après quoi je devrai consentir à une culpabilité factice en payant l’amende.
C’est ainsi qu’en particulier, j’’éprouve la dérive totalitaire du régime, la perversion de nos pouvoirs démocratiques déliquescents, la désintégration d’un service public protecteur et bienveillant. Ici et maintenant. Après que des années durant, d’autres venu.e.s d’ailleurs m’ont témoigné leurs vécus similaires et d’expériences bien pires, comme des avertissements répétés pendant qu’il en était encore temps.
C’est un combat personnel en défense de « positions de principe », qui doit sans doute être transformé et mené sur d'autres terrains de lutte. J’entrevois, je m’interroge, je cherche. Et dans la perspective de ce qui vient, je profile et affûte des armes de l'esprit. Je relis Hannah Arendt, Paul-Claude Racamier. Et je m'intéresse à Ariane Bilheran, Barbara Stiegler.
Je vous remercie de votre attention.
Franck Philippe TIMBAL
Les 10 dernières publications du pôle artistes